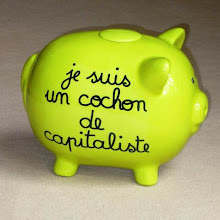1) La valeur travail
Pour Adam Smith, la richesse économique provient de façon tout à fait explicite du travail et non du capital. C’est la division du travail et le surtravail que le salarié réalise au profit du capitaliste qui génèrent la valeur ajoutée de l’entreprise […] Source de toute richesse, le travail apparaît ainsi comme le seul moyen de comparer les biens, d’en mesurer le prix. C’est la théorie de la valeur travail, par laquelle débute l’ouvrage fondateur du libéralisme : « Le travail est donc la seule mesure réelle de la valeur échangeable de toute marchandise. »
Ce passage rassemble en quelques phrases à peu près toutes les erreurs qu’a commises Adam Smith sur la notion de valeur. Le problème de la valeur est évidemment crucial en économie, et son péché originel a été de vouloir partir d’une notion intrinsèque de valeur (selon cette conception, la valeur d’une chose réside dans la chose elle-même). De plus, il tente systématiquement d’expliquer le prix d’une chose à partir de son coût de production, et en particulier à partir du travail nécessaire pour la fabriquer. Enfin, le travail devient pour lui l’unité de mesure qui permet de quantifier et de comparer les valeurs. L’introduction d’une unité de mesure ouvre la possibilité d’effectuer des calculs. Tous les développements récents de l’économie, qui font un usage immodéré des mathématiques, partent donc de l’idée que la valeur est mesurable. On va voir que c’est un principe très discutable.
A son actif, la valeur travail parvient à expliquer pourquoi un verre d’eau ne coûte presque rien. En revanche, elle n’apporte aucune lumière en ce qui concerne le prix d’un tableau de maître. De même, elle est incapable d’expliquer pourquoi un diamant est beaucoup plus cher qu’un verre d’eau. Et avec la valeur travail, on est encore plus démuni si l’on se trouve dans le désert en train de mourir de soif et que l’on veut céder un diamant contre un verre d’eau ! Cette inversion de valeurs est en effet incompatible avec la notion de valeur intrinsèque. Pressentant ces difficultés, Smith présente le paradoxe du diamant et du verre d’eau, et s’embrouille en tentant de distinguer valeur d’usage et valeur d’échange. Plus tard, Karl Marx repartira sur les mêmes fondations bancales, puisque sa théorie de l’exploitation repose entièrement sur la valeur travail de Smith. Mais toutes ces tentatives d’expliquer la formation des prix par la théorie de la valeur intrinsèque sont un échec patent.
On attribue à trois économistes la paternité de la théorie de la valeur subjective, qui permet de résoudre correctement le paradoxe du diamant et du verre d’eau. Deux d’entre eux – William Stanley Jevons et Léon Walras – introduisirent la notion d’utilité ou de satisfaction des besoins afin de mesurer la valeur d’une chose. L’utilité, ou l’urgence des besoins, étant une donnée très subjective, on comprend que la valeur du tableau de maître puisse être indépendante du travail fourni pour le peindre. De plus, dans le cas où l’on consomme ou possède plusieurs unités d’un bien, l’utilité de la dernière unité est inférieure à celle des précédentes. En effet, chaque unité supplémentaire est toujours utilisée pour satisfaire notre besoin le plus urgent, lequel est par définition moins urgent que ceux satisfaits par les premières unités. Ainsi, le verre d’eau dans le désert est cher parce qu’il satisfait notre besoin de survivre, tandis que le millième verre d’eau dans une ville est bon marché car il satisfait peut-être notre besoin de nous laver les mains.
Même ainsi, la théorie de Jevons et de Walras est moins satisfaisante que celle du véritable père de la valeur subjective : Carl Menger. Ce dernier, en effet, ne tenta pas de mesurer l’utilité ou la satisfaction. Dans sa théorie, la notion de valeur n’est pas une grandeur cardinale qui se réfère à un état psychologique, mais une notion relative. C’est l’importance relative du bien X par rapport au bien Y qui fait que, en un lieu et à un moment donnés, un individu préfère X à Y. En dehors des circonstances où un individu agit pour choisir X plutôt que Y, il est impossible de dire lequel des deux biens a la plus grande valeur. En particulier, on ne peut pas comparer la valeur d’un bien pour deux personnes. Mais nous sommes tellement influencés par le système des prix qu’il faut un peu de temps pour s’en convaincre.
Parmi les précurseurs de la théorie de la valeur subjective, on peut noter les scholastiques de l’école de Salamanque, et surtout l’abbé Etienne Bonnot de Condillac. Dans son Traité du commerce et du gouvernement, publié en 1776 – la même année que l’ouvrage de Smith ! – Condillac en avait déjà posé les bases. Menger s’inspira de Condillac pour bâtir un système qui corrigeait les errements de Smith en introduisant la subjectivité et le marginalisme. De plus, Menger se distingua de l’approche de Jevons et Walras – ainsi que de la plupart des économistes contemporains – en évitant d’introduire dans son système une quelconque mesure de la valeur.
Lorsqu’on prend en compte les trois caractéristiques de la valeur identifiées par Menger, la théorie de l’exploitation de Marx s’effondre. En effet, la relation entre l’employeur et le salarié étant vue comme un échange, les deux parties sont nécessairement gagnantes dans l’opération. L’employeur démontre en embauchant le salarié que le travail fourni par ce dernier a plus de valeur que son salaire. Mais il s’agit de la valeur comparée du travail et du salaire, valeur qui n’a de sens que pour cet employeur au moment où il prend la décision, et non d’une quelconque valeur intrinsèque de ce travail. Le salarié a la préférence inverse : pour lui le salaire qu’il reçoit a plus de valeur que la peine qu’il subit en travaillant. Pourtant personne ne songerait à dire qu’il exploite son employeur parce qu’il reçoit de lui plus qu’il ne donne ! Certes, le travail est toujours plus ou moins pénible : le salarié doit donner quelque chose pour recevoir un salaire, de même que l’employeur doit le payer pour recevoir son travail. C’est le principe même de l’échange que d’être obligé de donner quelque chose pour recevoir en retour.
Toute approche de la valeur par les coûts, telle que la théorie de la valeur travail, passe donc à côté du caractère essentiel de la valeur, à savoir sa subjectivité. C’est comme si un élève disait à son professeur qu’il mérite un A parce qu’il a passé 5 heures sur son devoir. Quiconque a déjà corrigé des copies sait que leur valeur n’a souvent rien à voir avec le temps passé dessus. Mais l’analogie s’arrête là car les copies peuvent être notées sur 20, ce qui permet de les comparer entre elles, tandis que la valeur d’un bien ne peut pas être comparée à celle d’un autre en général. La vision comptable de la production nous induit en erreur car elle rattache à l’objet des coûts quantifiables. Mettons qu’une entreprise industrielle enregistre des coûts de 10000 euros pour produire une voiture, et qu’une autre ait des coûts de 1000 euros pour produire une mobylette. Il est tentant de conclure que la voiture a plus de valeur que la mobylette. Mais pour un écologiste parisien, la mobylette peut avoir une valeur sentimentale ; la voiture peut être un handicap dans les embouteillages, être impossible à garer, sans compter qu’elle contribue au réchauffement climatique. Pour lui, acheter une mobylette pour 2000 euros sera avantageux alors qu’il n’envisagerait jamais de payer ce prix pour une voiture. A la trappe, les coûts de production, dès lors que l’on pense à la valeur subjective.
Pour terminer, il faut tout de même reconnaître qu’il y a un lien entre les coûts de production et le prix de vente. Si tout le monde était écologiste parisien, le constructeur automobile n’aurait personne à qui vendre ses voitures. Mais justement, il s’est lancé dans la construction de ce modèle parce qu’il anticipait qu’il pourrait trouver preneur à un prix supérieur à 10000 euros. Le constructeur a donc déterminé ses coûts en fonction du prix qu’il anticipait. C’est le prix de vente qui lui sert de guide pour calculer ses coûts, et non l’inverse. Imaginez un entrepreneur qui commencerait par mettre en place une ligne de production, puis constaterait ses coûts, et mettrait en vente le produit au coût de production plus une petite marge ! Il serait condamné à la faillite.
En résumé, la référence à Adam Smith est particulièrement trompeuse. Son biais productiviste est clair puisqu’un chapitre de La richesse des nations est intitulé Des parties constituantes du prix des marchandises. La valeur est un sujet sur lequel il s’est trompé sur toute la ligne, au point d’inspirer des générations d’économistes marxistes. Difficile dans ces conditions de voir en lui le père fondateur du libéralisme. En réalité, la valeur du travail, comme de tout autre service ou bien, ne peut être observée que sous forme d’inégalités lors d’un échange. L’employeur, en embauchant un salarié, démontre qu’il valorise son travail plus que le salaire offert. Le salarié démontre qu’il a l’ordre de préférence inverse à l’instant où il signe son contrat de travail. Mais en ce qui concerne les prix de vente, l’entrepreneur doit les deviner. La comptabilité lui permet seulement de s’assurer que son processus de production coûte moins cher que le prix de vente escompté. Ce n’est qu’une fois la production terminée que le processus du marché lui permet de découvrir les valeurs subjectives de ses clients, et de savoir si ses anticipations étaient correctes ou non. Modifier les règles comptables peut-il changer le comportement de l’entrepreneur ? Va-t-il faire appel à plus de salariés et moins de capital si l’on inscrit le « capital humain » à l’actif du bilan ? Pour répondre à cette question, il faut examiner le sujet du capital, et donc de l’intérêt.
2) Le capital et le profit
Avec la concurrence comme moteur de la croissance, l’horizon prévu par le libéralisme est peu équivoque et d’ailleurs fort connu des spécialistes : c’est la baisse tendancielle des profits, énoncée sous diverses formes dans La richesse des nations : « L’augmentation du capital qui élève les salaires tend à réduire le profit. Quand nombre de négociants transfèrent leur capital dans la même branche d’activité, la concurrence qu’ils se font a naturellement tendance à réduire les profits ; et quand le capital augmente du même montant dans toutes les activités menées par la société, la concurrence doit entraîner les mêmes effets. »
Parti sur de mauvaises bases en ce qui concerne la valeur, Adam Smith ne saurait avoir une compréhension correcte de l’intérêt. Fidèle à sa théorie de la valeur travail, il commence par définir le profit comme une composante du prix :
Il faut observer que la valeur réelle de toutes les différentes parties constituantes du prix se mesure par la quantité du travail que chacune d'elles peut acheter ou commander. Le travail mesure la valeur, non seulement de cette partie du prix qui se résout en travail, mais encore de celle qui se résout en rente, et de celle qui se résout en profit.
Puis il justifie l’intérêt par le profit :
[L’intérêt est] une compensation que l'emprunteur paye au prêteur, pour le profit que l'usage
de l'argent lui donne occasion de faire.
Ici, Adam Smith explique donc que l’entrepreneur qui réalise un profit grâce au prêt d’une banque verse à son créancier une compensation nommée intérêt. L’explication est maladroite. On ne voit pas ce qui oblige l’emprunteur à verser cette compensation, ni comment le temps intervient, ni pourquoi l’intérêt ne tend pas vers zéro sous l’effet de la concurrence entre banques. D’un côté, si entrepreneur trouve le moyen de multiplier la valeur de son investissement en une semaine, devra-t-il verser à la banque un intérêt de 100% par semaine ? De l’autre, si des banquiers sont en concurrence pour prêter à un entrepreneur, qu’est-ce qui empêche chaque banquier de proposer un taux plus bas que les autres pour remporter le marché, quitte à se rapprocher d’un taux zéro ?
Eugen von Böhm-Bawerk publie en 1890 une étude exhaustive des différentes théories de l’intérêt. Poursuivant sur les bases établies par Menger, une de ses contributions est de formuler le problème de l’intérêt comme un problème d’inégalité de valeurs subjectives. Tout comme les prix sur le marché des biens, le taux d’intérêt résulte de choix et d’échanges entre individus. Ces échanges nous permettent d’observer les préférences de ces individus entre certaines quantités de biens aujourd’hui et certaines quantités de biens à une date future. Ce sont ces préférences temporelles qui les conduisent, à un instant donné, à réaliser un prêt ou à contracter un emprunt, c’est-à-dire à accepter un échange étalé dans le temps avec une personne qui a des préférences inverses des leurs.
Il est important de souligner que l’intérêt n’est pas un phénomène monétaire, ni capitalistique, même si il se manifeste le plus souvent par des échanges monétaires. C’est un prix relatif entre des biens à des dates différentes. Il est déterminé par les préférences temporelles des individus et par cela seulement. Knut Wicksell développe ces notions et appelle taux d’intérêt naturel le taux observable sur le marché des échanges inter temporels sans risque (quand le remboursement est certain). On peut alors répondre aux questions posées plus haut : ce qui empêche le taux de tendre vers zéro, c’est la loi universelle selon laquelle un tiens vaut mieux que un tu l’auras ! La préférence temporelle des prêteurs fait qu’ils exigent toujours une compensation pour attendre. Lorsque deux prêteurs sont en concurrence, celui qui a la préférence temporelle la plus faible remporte le marché. Mais en aucun cas il ne prêtera sans intérêt, si bien que le taux ne descendra pas en dessous de ce qu’il est prêt à accepter. De même, lorsque des entrepreneurs sont en concurrence pour obtenir un prêt, le taux ne peut monter plus haut que leurs préférences temporelles respectives. Comme sur les autres marchés, la confrontation des offres et des demandes sur le marché des échanges inters temporels tend vers l’obtention d’un taux d’intérêt – c’est-à-dire d’un « prix » – uniforme.
On voit donc que le profit pour Adam Smith est nécessairement suspect, car il devrait tendre vers zéro sous l’effet de la concurrence. Karl Marx en déduira une théorie selon laquelle le capitalisme court à sa perte par l’annihilation progressive des profits. Sans aller jusque là, le raisonnement de Smith sert souvent à justifier toutes sortes d’interventions et de réglementations contre les profits abusifs. Puisque la concurrence n’est jamais « pure et parfaite », les profits réalisés par le capital sont certainement supérieurs à ce qu’ils devraient être « raisonnablement ». Il faudrait donc rééquilibrer la part des salaires dans la valeur ajoutée, etc. Mais ce que nous disent Böhm-Bawerk et Wicksell, c’est que sous l’effet de la concurrence et du marché, le taux de profit (sans risque) ne tend pas vers zéro mais vers le taux d’intérêt naturel. Ce dernier est strictement positif en raison de nos préférences temporelles. C’est en quelque sorte le taux de profit minimal. Si j’achète un kilo de pommes pour un euro, qui est leur prix de marché, je ne m’enrichis pas sur le dos du commerçant. J’échange un euro contre des biens qui ont une valeur subjective supérieure pour moi. Le commerçant ne s’enrichit pas non plus sur mon dos, puisqu’il cède un kilo de pommes contre une quantité de monnaie qui a une valeur subjective supérieure pour lui. Puisque chacun est à même de comprendre ce raisonnement, il est facile de voire qu’il s’applique également dans le cas du taux d’intérêt. Il n’y a pas égalité de valeurs entre 100 euros aujourd’hui et 105 euros dans un an – à supposer que le taux d’intérêt naturel soit de 5% – mais bien une double inégalité : 105 euros demain valent plus que 100 euros aujourd’hui pour le prêteur, et 100 euros aujourd’hui valent plus que 105 euros dans un an pour l’emprunteur. La preuve en est donnée par l’échange ; sans cette double inégalité, l’échange – c’est-à-dire le prêt – ne se ferait pas.
Cette propriété peut être observée dans un exemple très concret. Lorsqu’une entreprise embauche des salariés, elle n’a au début de son existence aucun produit à vendre. Le temps de produire des biens, et de les distribuer, elle peut mettre un temps assez long avant de générer du chiffre d’affaires. Il se peut même qu’elle doive investir d’abord en recherche et développement et qu’un délai de plusieurs années s’écoule avant que son flux de trésorerie s’équilibre. Pendant ce laps de temps, les salariés préfèrent généralement être payés. Ils pourraient renoncer à leur salaire, et demander en contrepartie une part des profits futurs. Cela s’appelle être actionnaire. Mais dans la plupart des cas, on aboutit spontanément à une certaine répartition des tâches : les salariés travaillent et demandent à être payés tout de suite ; les capitalistes attendent et demandent à percevoir la totalité des profits futurs. Il existe quelques recouvrements entre les deux fonctions avec les parts variables dans les salaires et l’intéressement pour les salariés, mais c’est une petite part des salaires. Le capitaliste permet donc aux salariés de recevoir leur salaire tout de suite. Sans lui, ils seraient obligés d’attendre, tout comme le boulanger, qui initialement construirait lui-même son four à pain, ne mangerait pas de pain pendant ce temps. La rémunération des salariés et des capitalistes dans une entreprise résulte simplement du fait que les premiers ont une préférence relativement plus forte pour les biens présents que pour les biens futurs.
Il y aurait encore beaucoup à dire, puisque au-delà de la notion d’intérêt il reste à comprendre ce qu’est un entrepreneur, l’incertitude, le risque. Intuitivement, on voit déjà que le temps doit jouer un rôle central pour comprendre ces notions. Mais déjà si l’on s’en tient à la simple question de l’intérêt, force est de conclure que Smith part de nouveau dans une mauvaise voie. Sa conception de l’intérêt comme une composante de la valeur est fausse, et surtout elle n’explique en rien comment se forme le taux d’intérêt. L’apport de Menger et Böhm-Bawerk a été de montrer qu’un taux d’intérêt, comme un prix, n’est que la manifestation instantanée de valeurs subjectives. On ne peut l’observer et découvrir le taux d’intérêt naturel que par un processus de marché, c’est-à-dire la rencontre d’une offre et d’une demande avec des individus qui réalisent des échanges inter temporels. Par conséquent, Smith n’est pas à même de comprendre ces forces qui, à tout moment sur le marché des capitaux, font tendre le profit sans risque vers le taux d’intérêt naturel. Faute d’avoir compris la nature de ce point d’équilibre naturel, il est tentant de lui substituer la notion de taux d’intérêt « raisonnable ». Les deux notions sont à vrai dire très proches, et la différence est subtile. Après tout, dire qu’un taux d’intérêt est raisonnable n’est rien d’autre qu’exprimer une certaine préférence temporelle. A ceci près que raisonnable se réfère à la préférence subjective de quelqu’un, tandis que le taux naturel est « raisonnable » dans le sens où il est la synthèse des préférences subjectives de myriades d’individus. Outre le fait qu’un individu qui impose ses valeurs subjectives aux autres est comparable à un dictateur, il faut faire remarquer que toute règle qui viserait à plafonner le taux de profit ou à le baisser en dessous d’un seuil est comparable à la mise en place d’un contrôle des prix. Sans rentrer dans les détails, on sait que le contrôle des prix est une façon parmi d’autres d’empêcher certains échanges de se réaliser, quand bien même ils sont souhaités par les individus concernés. La conséquence universelle et prévisible de tels mécanismes est la pénurie – en l’occurrence la pénurie de capitaux pour les entrepreneurs.